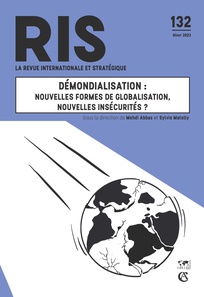Il y a exactement trente ans, en avril 1994, était signé l’Accord de Marrakech qui concluait un cycle de négociations commerciales, l’Uruguay Round, engagé sous l’égide du GATT (Accord Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce). L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) était instituée, et, contrairement au GATT, elle était dotée d’un statut d’organisation internationale. Par ailleurs, elle étendait ses compétences aux services (GATS ou AGCS) et à la propriété intellectuelle (TRIPs ou ADPIC). En outre, l’ancienne procédure de règlement des différends était réformée, afin d’empêcher les membres « défendeurs » de la bloquer.
Auteur : Jean-Marc SIROEN
Démondialisation et démultilatéralisation. Retour vers le pire ?
La mondialisation, autrefois perçue positivement, suscite désormais de l'anxiété et un possible rejet. Les comportements isolationnistes de leaders tels que Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine contribuent à ces inquiétudes. Les institutions internationales telles que l'ONU et l'OMC semblent impuissantes face à ces défis, affectant la coopération mondiale.
Les nouveaux habits du nationalisme économique
Le célèbre aphorisme de Romain Gary sur le patriotisme et le nationalisme est remis en question dans le contexte économique. Le nationalisme économique considère les relations internationales comme un jeu à somme nulle, tandis que le libéralisme promeut la coopération mutuellement bénéfique. La montée du nationalisme politique et économique au 21e siècle soulève des préoccupations sur ses implications.
L’héritage de Donald Trump
La politique économique internationale de Donald Trump, bien que controversée, a été peu contestée sur le fond. Les États-Unis, en raison de leur taille et de leur éloignement des grands marchés, ont traditionnellement adopté une approche protectionniste. Joe Biden a cherché l'apaisement avec les alliés tout en maintenant l'héritage économique de Trump.
Jacques Delors, l’Européen
L'article en ligne présente le portrait de Jacques Delors, un homme "constructeur" de l'histoire européenne. Jean-Marc Siroën évoque son parcours, de ministre de l'économie à président de la Commission européenne, en mettant en lumière les raisons de l'orientation atlantiste de la construction européenne et le "manque d'âme" de l'Europe. Ce parcours souligne la faiblesse des démocraties, mais aussi les vertus de la négociation, la coopération et la recherche de compromis.
L’érosion du libéralisme. La fin des illusions
La période glorieuse du libéralisme post-guerre froide, promettant progrès, coopération, paix et démocratie, semble révolue. Les crises mondiales et les inégalités internes dessinent un monde en proie au protectionnisme. La crise financière de 2007-2008 aurait-elle sonné le glas du libéralisme au profit du nationalisme ?
La réindustrialisation : évidence ou illusion ?
La France se mettrait-elle à adorer ce qu’elle avait autrefois dénigré : l’industrie ? Elle ne serait pas la seule. De l’Europe aux Etats-Unis, de l’extrême gauche à l’extrême droite en passant par le centre libéral, une ébauche de consensus tend aujourd’hui à s’imposer sur la nécessité de se réindustrialiser. Les uns y verront la réhabilitation des interventions de l’État, d’autres l’occasion de retrouver une souveraineté abîmée, d’accélérer la transition écologique, de revitaliser des territoires délaissés, de créer des emplois, de gagner en productivité, etc. Pourtant, si on peut s’entendre sur la réalité et les conséquences de la désindustrialisation, la « réindustrialisation » est-elle le bon concept pour inspirer les politiques ?
Thomas Piketty, Donald Trump et les importations chinoises
J’ai été très étonné d’entendre, sur les ondes de France Inter, Thomas Piketty, économiste de gauche, lu et reconnu dans le monde entier, faire sienne la théorie trumpienne du commerce international. Si je ne crois pas avoir entendu le terme de « déconnexion », il s’agit bien pour lui de réduire le déficit commercial de la France avec la Chine par une augmentation des droits douane. Après tout, la gauche et les syndicats américains avaient soutenu la politique protectionniste de Trump que son successeur, Joe Biden, n’a pas remis en cause.
Il y a cinquante ans : la fin du système de Bretton Woods
Le 15 août 1971, il y a juste 50 ans, le président Nixon annonçait, dans une allocution télévisée, la suspension de la conversion en or du dollar et une taxe de 10 % sur les importations, reversée aux exportations, améliorant ainsi la compétitivité des produits américains.
Annuler la dette. Pour quoi faire ?
L'annulation de la dette poserait davantage de problèmes qu'elle n'en résoudrait